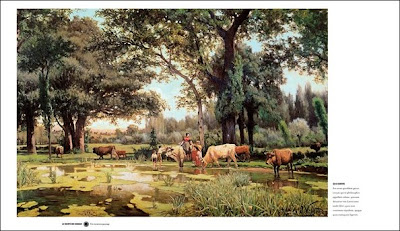Les Saints et les Animaux
d'Henri Bourgeois
d'Henri Bourgeois
Les belles histoires, souvent oubliées, du secours providentiel et miraculeux des animaux dans la vie des saints : La perdrix de Saint Jean l’évangéliste. Saint Patrice, son faon et sa biche apprivoisés. Saint Benoît nourrissant un corbeau. Le petit poisson de Saint Corentin. Le chien de Saint Roch…
Un ouvrage qui nous rappelle combien il est nécessaire de respecter toute la création. Une invitation à la douceur et à l'amour bienveillant envers tous ces animaux qui vivent autour de nous. Que serait la vie sur terre sans eux ?
Environ 120 histoires qui émerveilleront les petits comme les grands.
Les Saints et les Animaux, Henri Bourgeois, Editions Bénédictines, 2008, 228 pages
Pour en savoir plus
- Le site des Editions Bénédictines
- Des Saints et des bêtes, de Françoise Bouchard
- L'église et l'animal, d'Eric Baratay
- Les animaux, nos humbles frères, de Jean Gaillard
- Horizon de lumière, du Père Jean Martin
- L'âme des animaux, de Jean Prieur
- Requiem pour un nouveau monde, de Maud Fauvel
La première des légendes sur les animaux que nous offre l’ère chrétienne, est celle de Saint Jean l’évangéliste, et il va sans dire qu’elle est tout en faveur de la bonté et des égards que nous devons à nos frères inférieurs. Le disciple bien-aimé, demeuré le modèle par excellence de la douceur, était tout naturellement désigné pour être le premier protecteur des créatures du bon Dieu.
Un jour que le saint rentrait d’une de ses longues courses apostoliques, il rencontra sur son chemin une perdrix blessée. La pauvre petite bête, à moitié morte de froid, traînait péniblement l’aile et semblait implorer la pitié de l’apôtre. Un indifférent eût passé sans prendre garde à l’infortunée. Combien même, plus cruels encore, se fussent empressés de profiter de cette aubaine pour achever l’oiseau et lui faire prendre le chemin de la cuisine ! Saint Jean, lui, n’était ni indifférent, ni cruel : touché de compassion, il prit doucement la petite blessée, la mit dans son sein, la réchauffa et l’emporta chez lui, où, après avoir pansé de son mieux ses blessures, il lui donna à manger.
La perdrix, bientôt guérie, devint tout de suite apprivoisée et se prit d’une grande affection pour son sauveur. Saint Jean, de son côté, aimait beaucoup sa petite compagne. Lorsqu’il rentrait de ses courses, la perdrix s’empressait de venir au-devant de lui et le comblait de caresses, que le saint lui rendait à son tour. C’était avec sa perdrix que le doux apôtre, lorsqu’il avait bien travaillé, bien prié, aimait à prendre ses récréations, lui donnant à manger dans sa main et prenant plaisir à la voir voleter autour de lui. Lorsqu’elle mourut, il la pleura, et ce fut pendant longtemps un grand chagrin pour lui de ne plus trouver à ses côtés la mignonne petite bête à laquelle il s’était attaché.
La tradition ne nous a point conservé d’autre souvenir des relations entre Saint Jean l’évangéliste et les animaux, mais ce touchant exemple nous permet de supposer que, s’il avait sa petite préférée, le disciple bien-aimé devait être également bon et affectueux pour tous les autres animaux. On aime à se le figurer, de longs siècles avant François d’Assise, apprivoisant, caressant et réunissant autour de lui les petites bêtes de la création, et mettant en pratique les paroles de son divin Maître, auquel il avait entendu dire que le bon Dieu a soin de pourvoir lui-même à la nourriture des petits oiseaux !
Quoi qu’il en soit, sachons tirer un enseignement pratique de l’histoire de la petite perdrix du bon Saint Jean. Au lieu d’imiter ces orgueilleux et ces cruels, qui traitent de fausse sensiblerie l’affection pour les bêtes et accablent ces dernières de mauvais traitements, apprenons, à l’exemple du grand apôtre, qu’on peut parfaitement allier la charité envers le prochain, laquelle passe avant tout, bien entendu, avec certains égards pour les animaux, qui sont des créatures du bon Dieu, destinées par lui à être nos auxiliaires, mais nullement nos victimes. Certes, personne ne serait tenté d’accuser Saint Jean d’avoir manqué aux devoirs de la charité envers ses semblables, lui qui fut l’apôtre de la charité par excellence ! Et cependant cet apôtre de la charité aimait et caressait sa petite perdrix ! Bien avant la Société protectrice des animaux et M. de Grammont, il avait compris que les habitudes de cruauté envers les bêtes sont une mauvaise préparation aux devoirs de charité envers le prochain, et il avait proclamé et mis en pratique à l’avance ce beau précepte de Montaigne "que nous debvons la justice aux hommes et la grâce et la bénignité aux aultres créatures"
L’ouvrage d’Henri Bourgeois intitulé "Les saints et les animaux" (Editions de la Taillanderie, 1987) montre bien, dans sa préface, comment les relations des saints avec les animaux sont liés au merveilleux chrétien. Celui-ci a été mis en place au Moyen-Age à travers des hagiographies ou des légendes populaires dont on trouvera un bon exemple dans la "Légende dorée" de Jacques de Voragine.
On ne peut citer tous les saints, mais en voici quelques exemples :
- la perdrix apprivoisée par Saint Jean l’évangéliste
- Saint Paul, nourri par un corbeau dans le désert
- Saint Antoine, guérissant une truie
- Saint Blaise, soignant et guérissant les bêtes féroces
- Saint Gérasime et son fidèle lion Jourdain
- Saint Martin et les oiseaux (le martin-pêcheur)
- Saint Benoit, nourrissant un corbeau
- Saint Isidore et les oiseaux
- Saint Gilles, protégeant une biche
- les saints "bergers" et leurs moutons (Solange, Thorette et Germaine)
- Saint Hubert et Saint Eustache, convertis par l’apparition d’un cerf
- Saint Antoine de Padoue, prêchant aux poissons
- Saint Norbert, protecteur des loups
- l’âne obéissant de Saint François de Paule
- Saint François de Sales, demandant la grâce d’un chevreuil
- Saint Roch et son chien qui le soigne et lui apporte du pain
- le lièvre servant de guide à la bienheureuse Oringa
- Saint Joseph de Copertino, protégeant et sauvant les lièvres
- Benoit Cottolengo et ses serins
etc.
Il s’agit souvent de protection mutuelle, soit les saints protègent, soignent, ou guérissent des animaux (divers), soit les animaux se mettent au service des saints (aide, nourriture et… conversion). Vous trouverez bien d’autres cas de relations de saints avec les animaux, ainsi que les légendes ou anecdotes, qui s'y rattachent dans l'ouvrage ci-dessus (qui est en fait la réédition d’un ouvrage paru en 1898 chez Desclée de Brouwer) consultable à la Bibliothèque municipale de Lyon sous la cote [K18396]. ../..
Un ouvrage qui nous rappelle combien il est nécessaire de respecter toute la création. Une invitation à la douceur et à l'amour bienveillant envers tous ces animaux qui vivent autour de nous. Que serait la vie sur terre sans eux ?
Environ 120 histoires qui émerveilleront les petits comme les grands.
Les Saints et les Animaux, Henri Bourgeois, Editions Bénédictines, 2008, 228 pages
Pour en savoir plus
- Le site des Editions Bénédictines
- Des Saints et des bêtes, de Françoise Bouchard
- L'église et l'animal, d'Eric Baratay
- Les animaux, nos humbles frères, de Jean Gaillard
- Horizon de lumière, du Père Jean Martin
- L'âme des animaux, de Jean Prieur
- Requiem pour un nouveau monde, de Maud Fauvel
Un extrait du livre
La perdrix apprivoisée de Saint Jean l’évangéliste
par Henri Bourgeois, prêtre
La perdrix apprivoisée de Saint Jean l’évangéliste
par Henri Bourgeois, prêtre
La première des légendes sur les animaux que nous offre l’ère chrétienne, est celle de Saint Jean l’évangéliste, et il va sans dire qu’elle est tout en faveur de la bonté et des égards que nous devons à nos frères inférieurs. Le disciple bien-aimé, demeuré le modèle par excellence de la douceur, était tout naturellement désigné pour être le premier protecteur des créatures du bon Dieu.
Un jour que le saint rentrait d’une de ses longues courses apostoliques, il rencontra sur son chemin une perdrix blessée. La pauvre petite bête, à moitié morte de froid, traînait péniblement l’aile et semblait implorer la pitié de l’apôtre. Un indifférent eût passé sans prendre garde à l’infortunée. Combien même, plus cruels encore, se fussent empressés de profiter de cette aubaine pour achever l’oiseau et lui faire prendre le chemin de la cuisine ! Saint Jean, lui, n’était ni indifférent, ni cruel : touché de compassion, il prit doucement la petite blessée, la mit dans son sein, la réchauffa et l’emporta chez lui, où, après avoir pansé de son mieux ses blessures, il lui donna à manger.
La perdrix, bientôt guérie, devint tout de suite apprivoisée et se prit d’une grande affection pour son sauveur. Saint Jean, de son côté, aimait beaucoup sa petite compagne. Lorsqu’il rentrait de ses courses, la perdrix s’empressait de venir au-devant de lui et le comblait de caresses, que le saint lui rendait à son tour. C’était avec sa perdrix que le doux apôtre, lorsqu’il avait bien travaillé, bien prié, aimait à prendre ses récréations, lui donnant à manger dans sa main et prenant plaisir à la voir voleter autour de lui. Lorsqu’elle mourut, il la pleura, et ce fut pendant longtemps un grand chagrin pour lui de ne plus trouver à ses côtés la mignonne petite bête à laquelle il s’était attaché.
La tradition ne nous a point conservé d’autre souvenir des relations entre Saint Jean l’évangéliste et les animaux, mais ce touchant exemple nous permet de supposer que, s’il avait sa petite préférée, le disciple bien-aimé devait être également bon et affectueux pour tous les autres animaux. On aime à se le figurer, de longs siècles avant François d’Assise, apprivoisant, caressant et réunissant autour de lui les petites bêtes de la création, et mettant en pratique les paroles de son divin Maître, auquel il avait entendu dire que le bon Dieu a soin de pourvoir lui-même à la nourriture des petits oiseaux !
Quoi qu’il en soit, sachons tirer un enseignement pratique de l’histoire de la petite perdrix du bon Saint Jean. Au lieu d’imiter ces orgueilleux et ces cruels, qui traitent de fausse sensiblerie l’affection pour les bêtes et accablent ces dernières de mauvais traitements, apprenons, à l’exemple du grand apôtre, qu’on peut parfaitement allier la charité envers le prochain, laquelle passe avant tout, bien entendu, avec certains égards pour les animaux, qui sont des créatures du bon Dieu, destinées par lui à être nos auxiliaires, mais nullement nos victimes. Certes, personne ne serait tenté d’accuser Saint Jean d’avoir manqué aux devoirs de la charité envers ses semblables, lui qui fut l’apôtre de la charité par excellence ! Et cependant cet apôtre de la charité aimait et caressait sa petite perdrix ! Bien avant la Société protectrice des animaux et M. de Grammont, il avait compris que les habitudes de cruauté envers les bêtes sont une mauvaise préparation aux devoirs de charité envers le prochain, et il avait proclamé et mis en pratique à l’avance ce beau précepte de Montaigne "que nous debvons la justice aux hommes et la grâce et la bénignité aux aultres créatures"
Un extrait de la note du Département Fonds ancien
Relations entre les saints et les animaux
L’ouvrage d’Henri Bourgeois intitulé "Les saints et les animaux" (Editions de la Taillanderie, 1987) montre bien, dans sa préface, comment les relations des saints avec les animaux sont liés au merveilleux chrétien. Celui-ci a été mis en place au Moyen-Age à travers des hagiographies ou des légendes populaires dont on trouvera un bon exemple dans la "Légende dorée" de Jacques de Voragine.
On ne peut citer tous les saints, mais en voici quelques exemples :
- la perdrix apprivoisée par Saint Jean l’évangéliste
- Saint Paul, nourri par un corbeau dans le désert
- Saint Antoine, guérissant une truie
- Saint Blaise, soignant et guérissant les bêtes féroces
- Saint Gérasime et son fidèle lion Jourdain
- Saint Martin et les oiseaux (le martin-pêcheur)
- Saint Benoit, nourrissant un corbeau
- Saint Isidore et les oiseaux
- Saint Gilles, protégeant une biche
- les saints "bergers" et leurs moutons (Solange, Thorette et Germaine)
- Saint Hubert et Saint Eustache, convertis par l’apparition d’un cerf
- Saint Antoine de Padoue, prêchant aux poissons
- Saint Norbert, protecteur des loups
- l’âne obéissant de Saint François de Paule
- Saint François de Sales, demandant la grâce d’un chevreuil
- Saint Roch et son chien qui le soigne et lui apporte du pain
- le lièvre servant de guide à la bienheureuse Oringa
- Saint Joseph de Copertino, protégeant et sauvant les lièvres
- Benoit Cottolengo et ses serins
etc.
Il s’agit souvent de protection mutuelle, soit les saints protègent, soignent, ou guérissent des animaux (divers), soit les animaux se mettent au service des saints (aide, nourriture et… conversion). Vous trouverez bien d’autres cas de relations de saints avec les animaux, ainsi que les légendes ou anecdotes, qui s'y rattachent dans l'ouvrage ci-dessus (qui est en fait la réédition d’un ouvrage paru en 1898 chez Desclée de Brouwer) consultable à la Bibliothèque municipale de Lyon sous la cote [K18396]. ../..